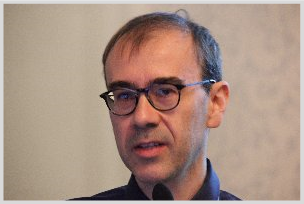
Pourquoi la FSU et du coup le SNUipp-FSU sont-ils organisés en courant de pensée ?
Ce choix prolonge une tradition du syndicalisme enseignant. Tous les syndicats sont traversés par des sensibilités diverses (songeons à la récente crise au sommet de FO…), mais lui seul a officialisé son pluralisme interne, pour organiser leur confrontation. Dans les années 1920, sa branche la plus combative, la Fédération Unitaire de l’Enseignement, est traversée par des conflits politiques au sujet de la Révolution russe. La reconnaissance des tendances, qui offre des garanties à la minorité anarchiste, évite la scission. Toutefois, les syndicalistes réformistes (les ancêtres du syndicat des enseignant-es UNSA) y voient un risque pour l’efficacité de l’action syndicale. Ils changent d’avis en 1947, lors de la scission confédérale. Contre l’ancêtre d’Unité et Action, mais avec le soutien de l’Ecole Emancipée, la majorité de la Fédération de l’Education Nationale choisit de quitter la CGT sans adhérer à FO. Le choix de l’autonomie n’était viable que si les cégétistes l’acceptaient, car ils disposaient de la masse critique pour faire un syndicat seul. Ils acceptent l’autonomie de la FEN en échange de la représentation proportionnelle aux élections internes et du droit d’avoir une double affiliation, CGT et FEN (abandonnée en 1954).
La majorité canalise les cégétistes en les enfermant dans un ghetto, elle impose l’homogénéité des exécutifs, c’est-à-dire que tous les membres des secrétariats viennent de ses rangs. L’Ecole Emancipée y est favorable, car si elle apprécie la liberté de parole que les tendances lui donnent, elle refuse toute responsabilité, dans un esprit syndicaliste révolutionnaire. La création de la FSU est l’occasion de remettre les choses à plat. Unité et Action a toujours regretté le côté rigide du fonctionnement en tendance, qui aboutit à une sclérose du débat, des prises de positions stéréotypées. Elle s’est longtemps battue pour introduire plus de souplesse, avec la possibilité de déposer des candidatures individuelles, sans tendance, ou celle de faire des listes communes. Le système en vigueur actuellement résulte donc d’un compromis. Il maintient les tendances mais associe les grands courants aux responsabilités. On assiste à une véritable mue de l’EE, au prix d’une scission avec Emancipation. Autant que les structures, la façon de s’en servir compte, les mentalités favorisent-elles l’échange d’idées et la construction de positions communes ? Il me semble que malgré les difficultés, une culture de la synthèse a émergé dans le SNUipp-FSU.
Qu’est-ce qui fait la spécificité du courant de pensée UA au sein du SNUipp ? Dans le paysage syndical ?
UA est à l’origine le courant cégétiste de la Fédération de l’Education Nationale. Fondamentalement, pour ses militant-es, la lutte n’est pas un dernier recours, un acte dérangeant, mais un aspect normal de l’action d’un syndicat. UA garde d’ailleurs des points communs avec ses cousins CGT de la Fonction publique, mais elle est d’abord une version musclée des traditions syndicales enseignantes, comme en atteste le choix de créer la FSU en 1992. Il reflète aussi le rejet de l’ouvriérisme qui n’a pas disparu dans la CGT. Michel Deschamps, le 1er secrétaire général de la FSU, théorisait l’idée qu’elle concilie action et proposition. Il est vrai qu’UA a toujours voulu joindre rassemblement du plus grand nombre et volontarisme dans l’action, mais cette tension existe aussi au sein de la CGT.
Les débats syndicaux étaient irrigués par des références idéologiques, alors qu’aujourd’hui, ils sont beaucoup plus pragmatiques. Pendant longtemps, les militant-es d’UA se définissaient aussi par une référence politique (au PCF, ou quelquefois dans l’aile gauche du PS). La création du SNUipp-FSU a occasionné à la fois un élargissement du spectre politique (aux verts notamment, ou à des associations parapolitiques comme ATTAC) et un recentrage sur la profession.
Pour UA, l’indépendance politique n’est pas la neutralité, d’autant que le syndicat doit assumer ses valeurs, y compris quand elles nécessitent de convaincre les collègues. La période que nous vivons impose à UA de créer ses propres repères.
Le succès d’UA s’explique par sa volonté constante de se situer dans une perspective majoritaire. Mais c’est la première fois que le courant occupe cette place dans le premier degré. La création du SNUipp s’est donc accompagnée d’une transformation profonde du courant, impulsée par le dynamique duo Daniel Le Bret /Nicole Geneix. UA SNUipp se réapproprie une partie des thèmes de l’ancienne FEN (sur les questions éducatives notamment) tout en développant une ligne combative. Le mouvement de 1995 a profondément marqué cette mutation : pas d’auto limitation dans la grève, mais la recherche d’une efficacité maximale, la recherche d’une radicalité qui soit suivie par les collègues. Mais la meilleure définition d’UA est encore qu’elle dirige la FSU et qu’elle assume les choix stratégiques du syndicat.

Laisser un commentaire